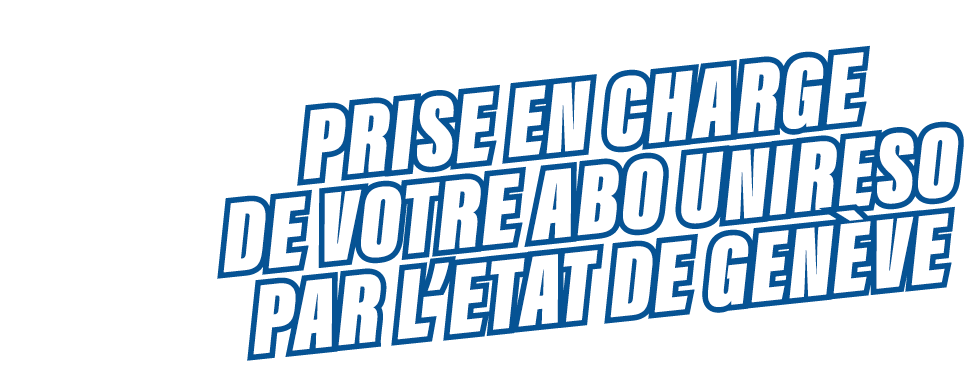Emmanuel Ravalet, chargé de cours au Laboratoire de sociologie urbaine à L’EPFL, était l’un des invités de La vie mobile. L’émission, proposée en partenariat avec les Transports publics genevois (tpg), est diffusée tous les derniers mardis du mois sur Radio Lac et One TV. Rencontre avec l’universitaire autour de la mobilité du futur.
Comment, selon vous, la mobilité du futur s’articulera-t-elle ?
Emmanuel Ravalet : Je voudrais d’abord insister sur l’idée que la mobilité de demain sera faite, pour une bonne part, des ingrédients d’aujourd’hui. La marche, le vélo, les transports publics, et la voiture seront au cœur des territoires et l’enjeu est de savoir à quoi chacun d’eux ressembleront et quelle en sera la part.
Dans retour vers le futur, Robert Zemeckis s’offre un scénario mobilité sur 30 ans et fait voler les voitures et les hoverboards en 2020, mais il a raté le tournant numérique. N’oublions pas cet élément dans nos scénarios mobilité pour 2030, 2040 ou 2050. Le numérique modifie notre rapport au temps et au territoire, et donc nos besoins de mobilité, mais il élargit aussi le champ des possibles en matière d’organisation/de flexibilisation des transports publics et des modes partagés (covoiturage, autopartage, transports à la demande, etc.).
Croire que l’avenir de la mobilité va permettre l’individualisation des déplacements avec des véhicules de plus en plus innovants, c’est manquer d’ambition et passer à côté d’enjeux climatiques et environnementaux qui, enfin, structurent les politiques de mobilité dans beaucoup de territoires. Cela permet de rappeler que la mobilité de demain dépendra des décisions d’aujourd’hui. C’est rassurant, mais c’est impliquant aussi !
Quels sont les aménagements d’ampleur que les villes doivent prévoir pour faciliter la mobilité 3.0 ?
ER : La mobilité 3.0 doit être une mobilité au service des populations, mais dans un cadre de respect d’engagements collectifs. En ce sens, il est nécessaire non pas de définir les modalités d’accueil des véhicules et des services de transport innovants, mais de réfléchir aux besoins des territoires et des populations qui y vivent pour définir dans quelles mesures ces véhicules et services peuvent être utiles, pertinents, ou… pas. Par exemple, la voiture autonome, si elle reste « individuelle », n’offre pas les garanties d’un équilibre du système de mobilité dans son ensemble de par la consommation d’espace en stationnement et en circulation qui caractérise ses prévisions d’usages. Aussi, les villes doivent s’organiser pour n’accueillir que les formes d’usages de la voiture autonome qui sont « collectivement rationnelles ». Pour aller jusqu’au bout de l’exemple, il convient sans doute de définir les modalités de mise en œuvre d’un service d’autopartage autonome, en l’articulant avec une offre structurante de transports publics notamment.
Les infrastructures doivent être aménagées en ce sens, mais encore une fois le numérique doit aider à cette articulation, notamment par le déploiement d’offres de type MaaS (Mobility as a Service).
Qu’est-ce qui freine aujourd’hui l’extension du réseau des TP ? L’exiguïté du territoire ? La configuration du canton de Genève ?
ER : En général, l’exiguïté d’un territoire ne freine pas le développement des réseaux TP puisqu’il participe à une concentration et une massification des flux qui sont les conditions mêmes de leur existence. Par contre, l’exiguïté des réseaux est une véritable contrainte de déploiement de l’offre, car elle détermine le champ des possibles en matière de demande. Mais les réseaux coûtent… et leur développement est lent car cela nécessite des portages politiques forts, des niveaux d’investissements élevés, et des travaux d’ampleur.
Il est nécessaire en 2023, de bien comprendre que l’on n’investit pas dans des infrastructures de transport pour générer du trafic induit, mais pour faire du report modal. Cela signifie que les infrastructures et services nouveaux ne doivent pas augmenter l’offre de transport tous modes au-delà de ce que suggère l’augmentation de la population… Et qu’une véritable politique en faveur des transports publics doit être articulée avec une politique de maintien, voire dans certains cas de limitation de l’offre routière.
Pour répondre à la question posée et de manière mi-sérieuse, mi-provocatrice, je dirais que ce qui freine le plus la croissance de l’usage des transports publics, ce sont les trop bonnes conditions de déplacement et de stationnement en voiture.
Retrouvez le podcast : https://carac.tv/replay/la-vie-mobile-votre-magazine-mobilite-a-geneve/187